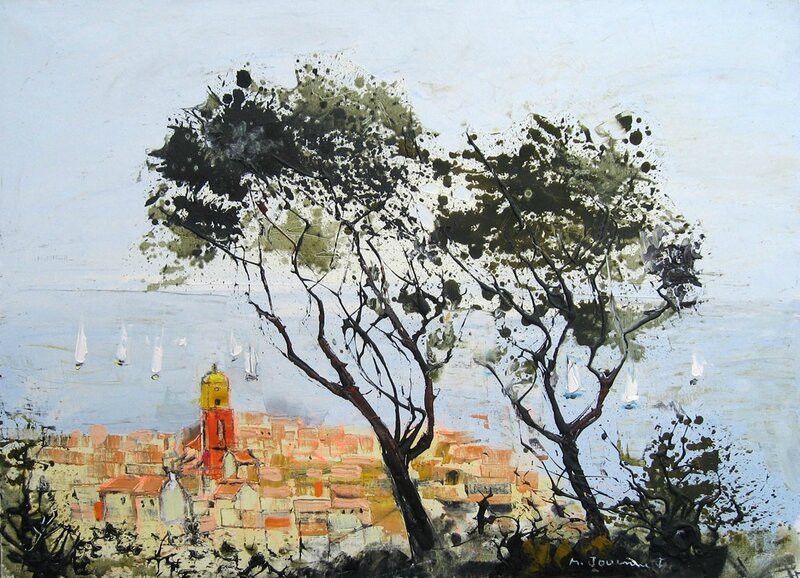Édouard Manet (néà Paris le 23 janvier 1832 - mort à Paris le 30 avril 1883) est un peintre français majeur de la fin du XIXe siècle. Initiateur de la peinture moderne qu'il libère de l'académisme, Édouard Manet est à tort considéré comme l'un des pères de l'impressionnisme : il s'en distingue en effet par une facture soucieuse du réel qui n'utilise pas (ou peu) les nouvelles techniques de la couleur et le traitement particulier de la lumière. Il s'en rapproche cependant par certains thèmes récurrents comme les portraits, les paysages marins, la vie parisienne ou encore les natures mortes, tout en peignant de façon personnelle, dans une première période, des scènes de genre.
Il naît dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés dans une famille de la bourgeoisie parisienne. Son père, est un haut fonctionnaire au ministère de la Justice. Sa mère est la fille d’un diplomate affectéà Stockholm et la filleule du Maréchal Bernadotte.
Bien qu’élevé dans une famille austère, le jeune Édouard découvre rapidement le monde artistique grâce à l’influence d’un oncle, le capitaine Édouard Fournier, qui fait apprécier les grands maîtres à ses neveux Édouard et Eugène, dans les galeries du musée du Louvre.
La scolarité de Manet semble avoir été décevante : le jeune garçon se montre régulièrement dissipé, assez peu appliqué et fait parfois preuve d’insolence. Il agrémente à cette époque la plupart de ses cahiers de caricatures.
Manet obtient cependant des résultats convenables. Mais il refuse de s'inscrire à la faculté de droit malgré les pressions de son père, et il demande à entrer dans la marine. Mais il échoue au concours de l'Ecole Navale.
Le 9 décembre 1848, il s'embarque comme pilotin sur le bateau école Le Havre et Guadeloupe, à destination de Rio de Janeiro. En 1849, Manet se représente au concours de l'Ecole Navale et il échoue de nouveau. Mais il est rentré avec une multitude de dessins dans ses bagages devant lesquels son père se rend à l'évidence : Édouard est un artiste.
Néanmois, Manet refuse de s'inscrire aux Beaux-Arts, comme le lui conseillent ses parents, et il entre dans l’atelier du peintre Thomas Couture, en 1850, où il reste environ six ans. Thomas Couture est l’une des figures emblématiques de l’art académique de la seconde moitié du XIXe siècle, avec un attrait marqué pour le monde antique, qui lui vaut un immense succès. Il est alors au sommet de sa gloire.
Manet consacre l’essentiel de ces six années à l’apprentissage des techniques de base de la peinture et à la copie de quelques œuvres de grands maîtres exposées au musée du Louvre.
Manet complète sa formation par une série de voyages à travers l’Europe : on trouve trace de son passage au Rijksmuseum d'Amsterdan en 1852. Il fait aussi deux séjours en Italie : le premier en 1853, le second en 1857. Outre les Pays-Bas et l’Italie, l’artiste a encore visité l'Allemagne et l'Europe centrale, en particulier les musées de Prague, Vienne, Munich ou Dresde.
L’indépendance d’esprit de Manet et son obstination à choisir des sujets simples déroute Couture. Les deux hommes se brouillent. Manet quitte l’atelier en 1856, et il emménage dans son propre local.
Après quelques années employées à copier de grands tableaux, c’est au Salon de 1859 que Manet se décide à dévoiler officiellement sa première œuvre, intitulée Le buveur d'absinthe. La toile, de facture réaliste, dénote l’influence de Gustave Courbet, mais constitue surtout un hommage à celui que Manet a toujours considéré comme « le peintre des peintres » : Diego Vélasquez. Mais Le Buveur d'absinthe, si peu académique, est refusé. Le jeune artiste bénéficie pourtant de plusieurs soutiens remarqués, avec notamment Eugène Delacroix, qui assure sa défense auprès du jury, et surtout Charles Baudelaire, qui vient de faire sa connaissance et s’emploie à le faire connaître dans la société parisienne.
Manet, à ce moment-là, est fasciné par l’art espagnol, qu’il associe au réalisme, par opposition à l’art italianisant des Académiques. Le Chanteur espagnol lui vaut son premier succès. Il est accepté au Salon de Paris en 1861 avec le portrait de ses parents.
Édouard Manet est un jeune homme plein d’assurance, volontiers amical et sociable. C’est pourquoi l’époque de ses premiers succès est aussi celle de son entrée remarquée dans les cercles intellectuels et aristocratiques parisiens.
Pour la première fois dans l’histoire du Salon officiel et annuel de Paris, on permet en 1863 aux artistes refusés d’exposer leurs œuvres dans une petite salle annexe à l’exposition principale, où les visiteurs peuvent les découvrir : c’est le fameux Salon des Refusés. Édouard Manet, en y exposant trois œuvres controversées, s’impose comme une figure de l’avant-garde.
1867 est une année riche en événements pour Manet : le peintre profite de l’Exposition universelle qui se tient à Paris, au printemps, pour organiser sa propre exposition rétrospective et présenter une cinquantaine de ses toiles. S’inspirant de l’exemple de Gustave Courbet, qui avait eu recours à la même méthode pour se détourner du Salon officiel, Manet n’hésite pas à puiser fortement dans ses économies pour édifier son pavillon d’exposition, et pour organiser une véritable campagne de publicité avec le soutien d’Emile Zola. Le succès, cependant, n'est pas à la hauteur des espérances de l’artiste : tant les critiques que le public boudent cette manifestation culturelle.
Édouard Manet a cependant atteint la maturité artistique et durant une vingtaine d'années il réalise des œuvres d’une remarquable variété, allant des portraits de son entourage (famille, amis écrivains et artistes) aux marines et aux lieux de divertissement en passant par les sujets historiques. Toutes vont influencer de façon marquée l’école impressionniste et l'histoire de la peinture.
Suzanne Leenhoff, une jeune Néerlandaise corpulente et placide qui était entrée à 20 ans en 1850 au service de la famille Manet comme professeur de piano d'Édouard et de son frère Eugène, met au monde en 1852 un garçon, que l'on suppose être le fils de Manet. Attachéà Suzanne pour l'équilibre qu'elle lui apportz, il finit par l'épouser en octobre 1863. La silhouette tranquille et apaisante de Suzanne figure à de nombreuses reprises dans l'œuvre de Manet.
Bien qu’aucune preuve directe de paternité ne puisse être établie, Édouard, est sûrement le père biologique du fils de Suzanne, Léon Leenhoff, qu’il a élevé d’ailleurs comme son fils. Les raisons ayant poussé le peintre à ne jamais reconnaître sa paternité, même après son mariage, restent assez énigmatiques (certains historiens considèrent que ce n'est pas son fils caché mais son demi-frère, Suzanne ayant eu une relation avec Auguste Manet), de même que la nature exacte des relations qu’il entretenait avec le jeune garçon... Ce dernier, jusqu’à un âge avancé, l’appelait « parrain », d’où une certaine ambiguïté accentuée par le fait que jusqu'à la mort de sa mère il ne se pensait pas comme le fils de Suzanne mais comme son frère.
Manet fait la connaissance d’une jeune peintre, Berthe Morisot. Il la persuade de poser pour lui dans différents tableaux. Berthe devient la belle-sœur de Manet en 1874 lorsqu’elle se marie avec le frère de ce dernier, Eugène. Influencée notamment par son beau-frère, elle s’imposera ensuite comme une figure essentielle du mouvement impressionniste.
Le visage de Victorine Meurent, aisément reconnaissable, est celui qui revient le plus régulièrement dans l’œuvre de Manet. Le peintre, subjugué par la beauté fraîche et un peu insolente de la jeune femme, en fait très rapidement son modèle préféré, notamment pour ses peintures de nu. Victorine apparaît ainsi dans les tableaux les plus célèbres de Manet : Le déjeuner sur l'herbe, Olympia, La chanteuse derue, La femme au perroquet....
Manet retrouvera chez un homme de lettres l’amitié profonde et spirituelle qu’il avait ressentie pour Baudelaire (mort en 1867), en la personne de Stéphane Mallarmé. Cette proximité entre l'artiste et l'écrivain amènera Édouard Manet à créer les illustrations qui accompagnent deux textes de Mallarmé.
Au fur et à mesure que Manet gagne en âge, un nombre grandissant de jeunes artistes se réclament de son esprit en s’opposant à leur tour à l'académisme. Parmi ces jeunes talents, certains vont se rapprocher de Manet et former le groupe dit "des Batignolles", ainsi nommé en référence au quartier des Batignolles où se trouvaient l’atelier de Manet et les principaux cafés que la bande fréquentait. On compte notamment dans ce groupe les peintres Paul Cézanne, Auguste Renoir, Frédéric Bazille ou Claude Monet.
De tous ces jeunes disciples, l’ami le plus intime de Manet est incontestablement Claude Monet, futur chef de file de l’impressionnisme. Les familles des deux peintres, deviennent vite très proches et passent de longues journées ensemble dans la verdure d’Argenteuil, chez les Monet. Ces visites régulières sont l’occasion pour Édouard Manet de réaliser plusieurs portraits intimistes de son ami, et surtout de s’essayer à imiter le style et les thèmes favoris de ce dernier, en particulier l’eau.
Édouard Manet est également très lié au peintre Edgar Degas, bien que ce dernier n’ait pas fait spécifiquement partie du groupe des Batignolles. Les deux hommes sont inséparables aux heures sombres de la guerre franco-prussienne de 1870. Manet et Degas se trouvent d’autres affinités pendant la Commune de Paris par leur opposition conjointe au parti versaillais. Bien que les deux hommes se soient souvent querellés et affrontés pour obtenir la prééminence dans l’avant-garde artistique, Degas conservera toujours une grande estime pour Manet et contribuera à promouvoir l’œuvre de ce dernier après sa mort.
À partir de 1868, les Manet ont pris l’habitude de passer leurs étés à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, où ils ont fait l’acquisition d’un appartement.
Édouard Manet, malade, fait une cure à Meudon Bellevue en 1880.
Affaibli depuis plusieurs années, il peint les deux dernières années des toiles de petit format qu'il réalise assis (nombreuse petites natures mortes de fruits et de fleurs), mais surtout des portraits de ses visiteuses au pastel, technique moins fatigante que la peinture à l'huile. Il s’éteint finalement le 30 avril 1883 à l’âge de cinquante et un ans, des suites d’une syphillis contractée à Rio. La maladie, outre les nombreuses souffrances et la paralysie partielle des membres qu’elle lui avait causées, a ensuite dégénéré en une gangrène qui a imposé de lui amputer le pied gauche onze jours avant sa mort.
D'après Wikipédia