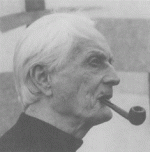LEAH RAINTREE
PRERAPHAELISME
Le Préraphaélisme est un mouvement né au Royaume-Uni en 1848. Ce mouvement tient la peinture des maîtres italiens du XVe siècle, prédécesseurs de Raphaël, comme le modèle à imiter.
Dante Gabriel Rossetti
L'histoire des préraphaélites débute avec la rencontre entre William Holman Hunt et John Everett Millaisà la Royal Academy Considérant que l'art anglais est sclérosé par le conformisme académique, ils souhaitent retrouver les tonalités claires, vives et chantantes des grands maîtres d'autrefois.
Rejoints par Dante Gabriel Rossetti, ils fondent officiellement leur "confrérie" en 1848, qui va s'élargir peu à peu.
Les préraphaélites aspirent à agir sur les mœurs d’une société qui, à leurs yeux, a perdu tout sens moral depuis la révolution industrielle. Leurs oeuvres doivent être morales, mais cela n'exclue pas l'esthétisme.
On n’imite plus les grands Maîtres de la Renaissance, contrairement à l'académisme victorien ; on veut retrouver la pureté artistique des primitifs italiens, prédécesseurs de Raphaël, qui privilégiaient le réalisme, le sens du détail et les couleurs vives.
John Everett Millais
En 1850, ils publient une revue périodique, The Germ (seuls quatre numéros verront le jour), dans laquelle ils exposent la théorie de leur mouvement. William Michael Rossettiénonce les règles du préraphaélisme :
- il faut avoir des idées originales à exprimer, étudier attentivement la nature pour savoir l’exprimer, aimer ce qui est sérieux et sincère dans l’art du passé et au contraire rejeter ce qui est conventionnel, auto-complaisant et appris dans la routine ;
- chaque figure doit être produite selon un modèle et d’après un seul modèle pour éviter toute idéalisation ;
- le dessin est minutieux, privilégiant les détails ; les couleurs vives et tonales sont souvent simples et franches, la réalité des personnages est préconisée dans une exécution lisse. Ils limitent les effets de profondeur et de volumes avec peu de jeux d’ombres et de lumière ;
- Leurs sujets de prédilection sont les thèmes bibliques, le Moyen Âge, la littérature et la poésie.
Le préraphaélisme est parfois contradictoire. Leurs préceptes exigent, par exemple, un réalisme intransigeant alors qu’ils dépeignent souvent un univers imaginaire. Un modèle unique est préconisé pour chaque personnage, mais Dante Gabriel Rossetti ne s’interdit pas la fusion de plusieurs modèles, pratiquant ainsi une forme d’idéalisation contraire à la notion d'objectivité de départ.
John Everett Millais
Le sigle PRB (Pre-Raphaelite Brotherhood), par lequel ils signent leurs tableaux durant leur période militante, est employé pour la première fois sur le tableau de Rossetti, The Girlhood of Mary Virgin.
À l'exposition de 1849 à la Royal Academy, les œuvres préraphaélites sont relativement bien accueillies. Cependant, le sigle PRB commence à intriguer la presse qui accuse les artistes de conspirer, d'être « membres de secte secrète pro-catholique ». Charles Dickens critique directement Millais, ouvrant les hostilités contre la confrérie.
Lors de l'exposition de 1851, les préraphaélites sont de plus en plus critiqués : pour leur perspective, leur minutie, le peu de jeux d'ombres et de lumières. John Ruskin prend la défense de la jeune confrérie par deux lettres restées célèbres qu'il envoit au magazine Times et qui permettent de réhabiliter la popularité des artistes. Les préraphaélites vivent l'apogée de leur triomphe lors de l'Exposition Universelle de 1855àParis.
A partir de 1857, ils arrêtent de signer PRB ; les peintres du début prennent des chemins différents : Woolner part chercher fortune en Australie, Hunt voyage en Palestine, Collinson se réfugie dans un couvent et Millais est élu membre associé de la Royal Academy of Arts, tandis que Rossetti continue lui dans la veine archaïsante des premiers tableaux préraphaélites. Il tente de refonder la confrérie qui voit l’arrivée notamment d'Edward Burne-Jones et de William Morris. Mais ce qu’on nomme communément la « seconde génération » ne respecte plus aussi scrupuleusement le précepte de représentation fidèle de la nature.
Evelyn De Morgan
Ce mouvement, qui fut pourtant de courte durée, eut une influence importante sur les mouvements artistiques du XIXe siècle, particulièrement l'art nouveau et le symbolisme.
Merci Wiki
BLANCHE HOSCHEDE
Blanche Hoschedé, ou Blanche Hoschedé Monet (née à Paris le 12 novembre 1865, morte à Nice le 8 décembre 1947) est une peintre française.
Elle devient la belle-fille de Claude Monet, lorsque, le 16 juillet 1892, sa mère épouse celui-ci, dont elle était déjà la maîtresse depuis de nombreuses années. Blanche Hoschedé est le modèle de Claude Monet pour plusieurs toiles, car celui-ci commence très tôt à la peindre, elle et sa sœur Suzanne.
Dotée elle-même d'un certain talent de peintre, elle commence à s'intéresser à la peinture dès l'âge de 11 ans, et fréquente l'atelier de son beau-père, dont elle porte souvent le chevalet. Elle en devient alors l'assistante et l'élève.
Elle épouse Jean Monet, le fils du peintre Claude Monet, en 1897.
En 1921, elle rencontre Georges Clémenceau, chez qui elle va peindre avec Claude Monet pendant une semaine, à Saint-Vincent-sur-Jard (Vendée), où elle retournera à plusieurs reprises, au cours des années 1920 ; l'homme d'État apprécie ses qualités de cœur et la surnomme « L'Ange bleu ».
Les sujets qu'affectionne Blanche sont des scènes de la nature, prés au bord du fleuve, ou arbres. Son style, impressionniste, est parfois difficile à distinguer de celui de Monet, en particulier pendant toute l'époque où elle demeure à Giverny, de 1883 à 1897 et puis de 1926 à 1947. Elle peint essentiellement pour son plaisir, mais organise cependant des expositions de ses œuvres, en 1927, 1931, 1942 ou encore, en 1947.
Outre son travail de peintre, disciple de Monet, dont elle est d'ailleurs le seul élève, Blanche Hoschedé joue par ailleurs un rôle essentiel dans la conservation des jardins de Giverny qui constituèrent une source essentielle de l'inspiration de son beau-père : en effet, elle met tous ses soins à leur préservation, pendant toute la période qui va de 1927 à 1947, et en particulier lors de l'occupation de Giverny par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale.
En haut à gauche : portrait par Claude Monet.
D'après Wikipédia
Cornelis VAN HARLEEM
Cornelis Corneliszoon van Haarlem ou Cornelis Cornelissen ou parfois francisé Corneille de Haarlem (né en 1562, mort le 11 novembre 1638 à Haarlem), est un peintre maniériste flamand (Provinces-Unies).]
Il naît dans une famille aisée. Ses parents ayant fui la ville lors du siège espagnol (décembre 1572 - juillet 1573), l'enfant est confié au peintre Pieter Pietersz (v.1540-1603), qui l'élève et lui apprend son art.
Après un voyage en France – où il ne peut poursuivre au-delà de Rouen à cause d'une épidémie de peste – (1579) et un séjour anversois d'un an destinéà parfaire sa formation sous la direction du maître Gillis Congnet, il revient à Haarlem où il s'installe définitivement vers 1580-81. C'est en 1583 qu'il y reçoit sa première grande commande, le portrait de groupe des membres d'une milice bourgeoise : le Banquet de la Garde civique de Haarlem. La même année, Cornelis rencontre Hendirk Goltzius et Carel Van Mander avec lesquels il fonda l'Académie de Haarlem.
En 1588, la diffusion de cinq de ses œuvres par l'entremise de gravures de Goltzus lui apporte une certaine célébrité. Cornelis est plus tard nommé peintre de la ville de Haarlem et, en 1630, il participe à la réorganisation de la guilde locale de Saint-Luc en réformant ses statuts médiévaux dans l'esprit de la Renaissance. Il est également le régent de l'hospice des vieillards de Haarlem entre 1613 et 1619.
Ses œuvres – souvent signées du monogramme CH – reflètent bien les travaux de l'Académie de Haarlem par une approche naturaliste, redevable de la pratique du dessin d'après nature comme de l'étude des sculptures antiques et qui a rapidement supplanté l'influence maniériste de Spranger.
Il a réalisé non seulement des sujets bibliques ou mythologiques, mais aussi des portraits et des natures mortes. L'artiste possède un humour assez particulier : ses nus ont souvent la plante des pieds sale et Vénus a les ongles noirs !
En haut à gauche : autoportrait de l'artiste
D'après Wikipédia
ARTS PREMIERS COTE D'IVOIRE - BETES
Les Bétés sont un peuple vivant dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dans ce qu'on appelle la « boucle du cacao ». Ils représentent environ 18 % de la population du pays, ce qui en fait la 2e ethnie du pays après les Baoulés. Appartenant au groupe culturel des Krous comprenant les Wés et les Didas, les raisons de la migration des Bétés demeurent inconnues. Certains Bétés migrèrent dans la région de Divo pour se fondre dans une population autochtone et former une autre ethnie, les Didas.
Aux Bétés se rattachent les Kouyas, les Niédébouas, et les Niabouas. La langue est différente que l'on soit à Gagnoa ou à Daloa, de plus les Bétés de Gagnoa ont une organisation sociale marquée par les Akans et les Mandes du sud voisins, ils ne connaissent pas de masque, tandis que ceux de Daloa et d’Issia en contact avec les Wés ont une institution du masque. Ils sont, avec les Senoufos, l'un des peuples les plus anciens du territoire dénommé"Côte d'Ivoire" dès 1893.
Le peuple Bété est composé de 93 tribus.
La religion bété comporte 2 niveaux. Un niveau théorique, très englobant, qui parle de l'univers et des relations entre Dieu (Lago ou Lago Tapé) et les hommes et un niveau pratique qui gère le quotidien des hommes et apporte des solutions aux problèmes (santé, désordre social, etc.).
En dépit de quelque variantes notées, il y a un fond culturel commun. Le culte du bagnon est présent dans toutes les régions bété. Chaque village a son bagnon. Il est désigné selon des critères physiques et moraux. Il est respecté et consulté en raison de sa vie exemplaire. On lui voue un véritable culte. La production artistique est riche et variée. Elle est dominée par la danse et la chanson. Elles régissent les événements, heureux ou malheureux, de la vie sociale. Chaque région a son pepe ou tite, semaine artistique tournante qui rassemble plusieurs villages.
Les Matriclans (Lêlé) existent chez les Bétés de Gagnoa. Le lêlé est une organisation parentale (matrilinéaire) qui prend a contre-pied l'organisation parentale (patrilinéaire) prépondérante en pays béyé. Cette organisation parentale est très répandu chez les Zédis, les Zabias et les Gbadis. Toutefois les Nékédis, les Niabrés, les Paccolos et les Guébiés ne la méconnaissent pas, car certains de leurs ressortissants (ceux qui ont une mère issue de l'une de ses trois tributs précités) se réfèrent à leur matriclan. Il faut aussi noter que le lêlé existe également chez les Didas.
Les Lêlés regroupe chacun des milliers de personnes. Le nom de ces matriclans est celui des six ancêtres féminines dont la connexion généalogique avec les mères vivantes sont impossibles àétablir, il s'agit de figures mythique donnant lieu à une grande variété de récits.
Le lêlé c'est appartenir a une fratrie, on est membre de cette fratrie par la mère. Les hommes et les femmes d'un même lêlé sont considérés comme frères et sœurs, ce qui a pour effet d'empêcher une éventuelle union conjugale.
D'après Wikipédia
AUGUSTE HERBIN
Auguste Herbin, néà Quiévry (Nord) le 29 avril 1882 et mort à Paris le 31 janvier 1960, est un peintre français.
Il étudie à l'École des Beaux-Arts de Lille de 1898 à 1901 dans l'atelier de Pharaon de Winter puis s'installe à Paris.
Il peint d'abord dans le style impressionniste.
Il se rapproche progressivement du cubisme après avoir rencontré Pablo Picasso et Georges Braque en 1909 au Bateau-Lavoir. Il est également encouragé dans cette voie par son amitié avec le critique d'art et collectionneur allemand Wilhelm Uhde. Au Salon des Indépendants de 1910 il est exposé dans la même salle que Jean Metzinger, Albert Gleizes et Fernand Léger, et en 1912 il participe à l'importante exposition de la Section d'Or. Il suit ses amis à Céret entre 1913 et 1923 où il signera plusieurs œuvres cubistes.
Pendant la première guerre mondiale, Herbin est affectéà la décoration d'une chapelle militaire au camp de Mailly-le-Camp, et plus tard à des travaux de camouflage dans une usine d'aviation.
Herbin produit ses premières toiles abstraites en 1917. Il est remarqué par Léonce Rosenberg qui lui achète plusieurs toiles et le prend sous contrat à la Galerie de l'Effort Moderne où il expose à plusieurs reprises entre 1918 et 1921. En 1919 Herbin décide d'abandonner le cubisme, pour lui dépassé. Il réalise alors sa série d'« objets monumentaux ». Ses peintures sur bois géométriques en relief remettent en question le statut de la peinture de chevalet. Cependant elles sont très mal accueillies.
Herbin se retire au Cateau-Cambrésis (Nord). Il épouse en 1922 Louise Bailleux. Entre 1922 et 1925 Herbin revient, en proie au doute et sur les conseils de Rosenberg, à un style figuratif. Il désavouera plus tard les paysages, les natures mortes et les scènes de genre de cette époque.
En 1931 il expose au Salon Association 1940 d'où sortira le groupe Abstraction-Création qu'il fonde avec Georges Vantongerloo. Il se consacre dans ces années à une peinture entièrement géométrique faite de formes simples en aplats de couleurs pures, alternant avec des formes ondulantes. En 1946 Herbin met au point son « Alphabet plastique », essai de codification des correspondances entre lettres, couleurs et formes. En 1949 il présente à la galerie La Gentilhommière à Paris son livre L'art non figuratif, non objectif où il expose son alphabet plastique, livre qui deviendra l'une des références majeures de la peinture abstraite de cette époque. A partir d'un répertoire de 26 couleurs, correspondant chacune à une lettre de l'alphabet et à des formes géométriques (triangle, cercle, demi-cercle, quadrilatère), ainsi qu'à une sonorité, il "illustre" un mot en fonction des correspondances.
En 1953 Herbin est frappé d'hémiplégie. Il réapprend à peindre de la main gauche.
Il meurt en 1960.
Kees VAN DONGEN
Kees Van Dongen est un peintre français d'origine néerlandaise, de sensibilité libertaire dans sa jeunesse, né le 26 janvier 1877 à Delfshaven, dans la banlieue de Rotterdam (Pays-Bas) et mort, à l'âge de 91 ans, le 28 mai 1968 à Monaco.
En 1892, à l’âge de 16 ans, Kees Van Dongen commence des études en peinture à l’Académie royale des beaux-arts de Rotterdam. De 1892 à 1897, il fréquente le Quartier Rouge portuaire. Durant cette période, il peint des scènes de matelots et de prostituées.
D'inspiration anarchiste, il illustre en 1895 avec Jan Krulder l’édition hollandaise de l'ouvrage de Pierre Kropotkine intitulé L’Anarchie.
En 1901, il épouse Augusta Preitinger, qu'il avait rencontrée à l’Académie.
Installéà Paris, en 1904, il expose au Salon des indépendant et rencontre Maurice de Vlaminck et Henri Matisse. Il participe à l’exposition controversée de 1905 du Salon d'automne. Les couleurs vives des œuvres seront à l’origine du nom de ce groupe de peintres : les Fauves.
Après la Première Guerre mondiale, il s'installe près du bois de Boulogne et fréquente les milieux privilégiés. Il a vécu notamment dans le palais de marbre rose du Vésinet, appartenant à la marquise Luisa Casati. Il est décoré de la Légion d'honneur en 1922. Mais ce n'est qu'en 1929 qu'il obtient la nationalité française.
Il a aussi été brièvement membre du mouvement expressionniste allemand Die Brücke.
En octobre 1941, en compagnie d'autres peintres et de sculpteurs tels que Charles Despiau, Paul Belmondo, Derain, Dunoyer de Ségonzac, ou encore Vlaminck, Van Dongen acceptent de participer à un « voyage d’études » en Allemagne organisé par Arno Breker. Bien que la contrepartie de ce déplacement, vivement « conseillé » par le gouvernement allemand, doit être la libération d'artistes français alors prisonniers de guerre, ce voyage dans l'Allemagne nazie leur est à tous sévèrement reproché. Ce voyage est en outre très largement exploité par la propagande nazie.
D'après Wikipédia
MINIATURES PERSANES : ECOLE DE BOUKHARA (XVIe)
Lorsque la capitale est transférée à Boukhara dans les années 1520, le patronage des arts se poursuit. Le style de la ketâbkhâneh de Boukhara est proche de celui de la bibliothèque de Hérat, ce qui prouve les liens entre elles. De 1512 à 1536, le nouveau khan réunit à Boukhara les meilleurs artistes et calligraphes de son temps et en particulier ceux de Hérat, prise en 1529, comme le calligraphe Mir Ali ou le peintre Sheikhzadeh.
Ce nouveau style boukhariote se prolonge jusqu'en 1575 environ.
Les manuscits commandés par Abdullah Khan (1557-1598), comme un exemplaire du Livre des rois de 1564, possèdent une palette limitée et présentent des personnages dans un style déjà démodé avec des paysages plutôt pauvres. Certains artistes partent pour le Deccan et Golkonda, où ils trouvent du travail à la cour du sultan. L'influence de l'école de Boukhara en Inde est perceptible. C'est ainsi que travaillent à la cour de l'empereur Jahangir, grand admirateur de la miniature persane, deux artistes originaires d'Asie centrale : Mohammad Mourad de Samarcande et Mohammed Nadir, ce dernier gagnant la réputation de portraitiste distingué. La tradition de la miniature d'Asie centrale se poursuit jusqu'au XVIIe siècle. Un exemplaire du Boustan de Saadi est conservéà la Chester Beatty Library de Dublin, daté de 1616. Trois artistes ont pris part aux illustrations: Mohammed Shérif, Mohammad Dervish et Mohammad Mourad. Une variante de ce recueil, datée de 1649, est conservée également dans ce même lieu.
L'Asie centrale est envahie par les Moghols en 1646-1647, ce qui privilégie les relations avec l'Inde et amène les artistes de Samarcande et de Boukhara à s'inspirer de modèles moghols, comme on le remarque dans l'exemplaire du Khamseh (1648) conservéà la Bibliothèque nationale russe de Saint-Pétersbourg.
Au XVIIIe siècle, les miniatures de l'école de Boukhara tombent au rang de simples productions commerciales. Des miniatures s'en inspirant sont produites en abondance dans les ateliers du Cachemire tout au long du XVIIIe et du XIXe siècles.
D'après Wikipédia
HORFEE
Artiste néà Paris en 1982. Nom également orthographiéHorphéou Horphée. Il a étudié aux Beaux-Arts de Paris. Il débute les graffitis dans le début des années 2000.
En mars 2011, il fait sa première exposition personnelle à la galerie Cetal. Salué pour son audace et son style, sa carrière ne cesse de se développer, notamment en outre-Manche.
VASSILY KANDINSKY
Vassily Kandinsky, néà Moscou (Russie) le 16 décembre (4 décembre) 1866 et mort à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) le 13 décembre 1944 est un peintre et graveur russe et un théoricien de l’art. Considéré comme l’un des artistes les plus importants du XXe siècle, il est un des fondateurs de l'art abstrait.
Né dans un milieu aisé, à Moscou, Vassily a cinq ans lorsque son père décide de s'installer au bord de la mer Noire pour raisons de santé. Vassilily passe son enfance à Odessa, où ses parents se séparent. Il vit chez son père, et chaque jour, sa mère lui rend visite. L'éducation de Vassily est confiée à sa tante maternelle, Élisabeth Ivanovna, qui l'initie au dessin et à la peinture. Sa mère se remarie avec un médecin d'Odessa. Chaque année, pendant son adolescence, il accompagne son père pour un voyage à Moscou.
En août 1885, il s'inscrit à l’Université de Moscou en faculté de Droit. En 1892, il obtient son diplôme de droit et épouse sa cousine Anja Shemyakina, une des rares étudiantes de l'université de Moscou. Ils divorceront en 1911.
Ce n'est qu'à 30 ans qu'il décide de commencer des études de peinture. En 1896, il s’installe à Munich, où il étudie à l’Académie des Beaux-Arts. Il retourne à Moscou en 1918, après la Révolution russe.
La création par Kandinsky d’une œuvre purement abstraite n’est pas intervenue comme un changement abrupt, elle est le fruit d’un long développement, d’une longue maturation et d’une intense réflexion théorique fondée sur son expérience personnelle de peintre et sur l'élan de son esprit vers la beauté intérieure et ce profond désir spirituel qu’il appelait la nécessité intérieure et qu’il tenait pour un principe essentiel de l’art.
Il se souvient qu’étant enfant, il était fasciné et exceptionnellement stimulé par la couleur. C’est probablement liéà sa synesthésie, qui lui permettait littéralement de transformer les sons en couleurs. En 1889 il participe à un groupe ethnographique qui voyage jusqu’à la région de Vologda au nord-est de Moscou pour étudier les coutumes relatives au droit paysan. Il raconte dans Regards sur le passé qu’il a l’impression de se mouvoir dans un tableau lorsqu’il rentre dans les maisons ou dans les églises de cette région décorées des couleurs les plus chatoyantes. Son étude du folklore de cette région, en particulier l’usage de couleurs vives sur un fond sombre a rejailli sur son œuvre primitive. Cette même année, avant de quitter Moscou, voyant une exposition de Monet, il est impressionné par la représentation d’une meule de foin, qui lui montre la puissance de la couleur utilisée presque indépendamment de l’objet lui-même.
Le temps que Kandinsky a passéà l’École des Beaux-Arts est facilité par le fait qu’il est plus âgé et plus expérimenté que les autres étudiants. Il commence une carrière de peintre tout en devenant un véritable théoricien de l’art du fait de l’intensité de ses réflexions sur son propre travail. Malheureusement, très peu de ses œuvres de cette période ont subsisté au temps.
Une peinture fondamentale de Kandinsky des années 1900 est probablement Le cavalier bleu (Der Blaue Reiter, 1903) qui montre un personnage portant une cape chevauchant rapidement à travers une prairie rocailleuse. Kandinsky montre le cavalier davantage comme une série de touches colorées que par des détails précis. En elle-même, cette peinture n’est pas exceptionnelle, lorsqu’on la compare aux tableaux d’autres peintres contemporains, mais elle montre la direction que Kandinsky va suivre dans les années suivantes, et son titre annonce le groupe qu’il va fonder quelques années plus tard.
La musique a eu une grande influence sur la naissance de l’art abstrait, étant abstraite par nature et ne cherchant pas à représenter vainement le monde extérieur, mais simplement à exprimer de façon immédiate des sentiments intérieurs à l’âme humaine. Kandinsky utilise parfois des termes musicaux pour désigner ses œuvres.
En plus de la peinture elle-même, Kandinsky se consacre à la constitution d’une théorie de l’art. Il a contribuéà fonder l’association des Nouveaux Artistes de Munich dont il devient le président en 1909. Le groupe est incapable d’intégrer les approches les plus radicales, comme celle de Kandinsky, du fait d’une conception plus conventionnelle de l’art, et le groupe se dissout fin 1911. Kandinsky fonde alors une nouvelle association, Le Cavalier Bleu (Der Blaue Reiter) avec des artistes plus proches de sa vision de l’art tels que Franz Marc.
Kandinsky est généralement considéré comme étant l’auteur de la première œuvre non figurative de l’histoire de l’art moderne, une aquarelle de 1910 qui sera dite « abstraite ». Certains historiens ou critiques d'art ont soupçonné Kandinsky d'avoir antidaté cette aquarelle pour s'assurer la paternité de l'abstraction...
Son premier grand ouvrage théorique sur l’art, intitulé Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier, paraît fin 1911. Il expose dans ce court traité sa vision personnelle de l’art dont la véritable mission est d’ordre spirituel, ainsi que sa théorie de l’effet psychologique des couleurs sur l’âme humaine et leur sonorité intérieure. L’Almanach du Cavalier Bleu est publié peu de temps après. Ces écrits de Kandinsky servent à la fois de défense et de promotion de l’art abstrait, ainsi que de démonstration que toute forme d’art authentique est également capable d’atteindre une certaine profondeur spirituelle. Il pense que la couleur peut être utilisée dans la peinture comme une réalité autonome et indépendante de la description visuelle d’un objet ou d’une autre forme.
L'arc noir (1912) est une des premières œuvres abstraites (qui ne représente rien de la réalité), et conçue comme telle, de l’histoire de l’art. Elle ne représente rien d'autre que des formes et des couleurs libérées de la « figure », de la « représentation » du monde. Cette liberté des formes tend à provoquer des émotions, des sentiments par le jeu de la composition, des harmonies colorées, des équilibres, des masses et du mouvement organisé autour de l'arc noir. Le geste improvisé du peintre révèle malgré tout une mise en scène réfléchie, pensée, où rien n'est laissé au hasard pour déclencher chez le spectateur une « vibration ». Kandinsky cherche ici à restituer la musique de Wagner, d’où le terme abstraction « lyrique » (liéà la musique).
Durant les années 1918 à 1921, Kandinsky s’occupe du développement de la politique culturelle de la Russie, il apporte sa collaboration dans les domaines de la pédagogie de l’art et de la réforme des musées. Il se consacre également à l’enseignement artistique avec un programme reposant sur l’analyse des formes et des couleurs, ainsi qu’à l’organisation de l’Institut de culture artistique à Moscou. Il peint très peu durant cette période. Il fait la connaissance en 1916 de Nina Andreievskaïa qui deviendra son épouse l’année suivante. Kandinsky reçoit en 1921 pour mission de se rendre en Allemagne au Bauhaus de Weimar, sur l’invitation de son fondateur, l’architecte Walter Gropius. L’année suivante, les Soviétiques interdirent officiellement toute forme d’art abstrait, car jugé nocif pour les idéaux socialistes.
Il enseigne au Bauhaus jusqu’à sa fermeture par les nazis en 1933. Il émigre alors en France et y vit le reste de sa vie, acquérant la nationalité française en 1939.
À Paris, il se trouve relativement isolé, d’autant que l’art abstrait, en particulier géométrique, n’est guère reconnu : les tendances artistiques à la mode sont plutôt l’impressionnisme et le cubisme. Il vit et travaille dans un petit appartement dont il a aménagé la salle de séjour en atelier. Des formes biomorphiques aux contours souples et non géométriques font leur apparition dans son œuvre, des formes qui évoquent extérieurement des organismes microscopiques, mais qui expriment toujours la vie intérieure de l’artiste. Il recourt à des compositions de couleurs inédites qui évoquent l’art populaire slave et qui ressemblent à des ouvrages en filigrane précieux. Il utilise également du sable qu’il mélange aux couleurs pour donner à la peinture une texture granuleuse.
À partir de la mort de Vassily Kandinsky et durant une trentaine d’années, Nina Kandinsky n’a cessé de diffuser le message et l’œuvre de son mari. L’ensemble des œuvres en sa possession ont été léguées au Centre Georges Pompidou, à Paris, où l’on peut voir la plus grande collection de ses peintures.
Nina Kandinsky créa en 1946 le prix Kandinsky « destinéà couronner la recherche de jeunes peintres dans le domaine de l’abstraction » et décerné pour la première fois à Jean Dewasne.
D'après Wikipédia
PEINTURE ROMANTIQUE
La peinture romantique est un courant pictural issu mouvement romantique qui s’étend environ de 1770 à 1870 (soit cent ans).
Au XVIIIe siècle, l'influence française dans le domaine des arts s'étend à toute l'Europe. L'Angleterre tente de s'affranchir de cette domination, mais sa différence se fait entendre principalement dans les domaines philosophique et de la jurisprudence. Vers 1770, de grands changements commencent à apparaître et on commence à en voir les manifestations dans le domaine de l'Art, et la France reste au cœur de ces bouleversements.
Johann Heinrich Füssli
La découverte et l'exploration de Pompéi (1750) et d'Herculanum sont considérés par les historiens comme signifiant l'apparition du néoclassicisme. Il s'agit principalement d'un retour fantasmé et imaginatif à l'antiquité gréco-romaine. En architecture, ce renouvellement par l'inspiration de modèles architecturaux antiques a pris très facilement en France. En sculpture également. Ce retour à un style palladien aura un fort retentissement, notamment lors de l'émergence de formes artistiques propres au continent nord-américain : en 1770, ce type d'architecture « néo-palladienne » se combinera à des formes originales pour supplanter, en Amérique, le style architectural des colons. Le romantisme est considéré comme un art des temps anciens.
1770-1820 - Préromantisme
Cette période est caractérisée par le fait qu’elle se développe en parallèle avec le néoclassicisme mais en opposition avec cette période : c’est aussi à ce moment-là qu’apparaissent les nouvelles thématiques des légendes nordiques, de l’histoire moderne, du paysage en tant que reflet de l’âme. L'importance de l’Angleterre et de l’Allemagne est très grande.
À l'origine, le romantisme est un courant littéraire dont les œuvres vont influencer des peintres qui vont contribuer àétendre ce courant à toute une série d’arts.
En Angleterre, cette influence provient surtout d’une œuvre de James McPherson, Poèmes d'Ossian (1760). Ce chef-d’œuvre de la littérature anglaise va enthousiasmer toute l’Europe - et notamment Goethe, Germaine de Staël, Napoléon, Ingres. Ossian est un poète celtique imaginaire dont McPherson dit qu’il a retrouvé les poèmes et les a ensuite traduits ; bien sûr, il les a écrits lui-même.
Caspar David Friedrich
Les peintres anglais les plus connus de cette époque sont Johann Heinrich Füssli, William Blake, Thomas Girtin, et Thomas Gainsborough et les grands paysagistes William Turner, Thomas Jones, Alexander Cozens et John Constable.
L’Allemagne subit l’influence du mouvement littéraire Sturm und Drang (tempête et élan). Les adeptes de ce mouvement sont des jeunes personnes qui sont opposés au siècle des Lumières. Aux idéaux universalistes, ils opposent les exigences de leur sensibilité. Les peintres allemands importants de l’époque sont Philipp Otto Runge, Caspar David Friedrich et Karl Friedrich Schinkel. Un groupe d’artiste va aussi se développer, les Nazaréens. Il s'agit d'un groupe d’artistes issus de l’académie de Vienne, installés à Rome et inspirés par la littérature romantique allemande. Refusant les théories classiques de Winckelmann, ils veulent revenir « au début de la peinture ». Leurs œuvres évoquent la peinture italienne du XVe siècle. Ils s’inspirent de la religion catholique et du nationalisme.
La France n’est pas en reste. Elle trouve son inspiration littéraire dans les écrits de Jean-Jacques Rousseau, Madame de StaPel, Pivert de Senancour et Chateaubriand. Les peintres représentatifs de cette période sont : Anne-Louis Girodet, Antoine-Jean Gros.
L'Espagne peut se vanter d’avoir, déjàà l’époque, un grand nom du romantisme : Francisco Goya. Influencé par Vélasquez, il sera l'un des peintres les plus puissants et visionnaires de l'époque.
Anne-Louis Girodet
1820-1850 - L'apogée du romantisme
L’Angleterre et l’Allemagne ne sont plus les pays les plus puissants en matière de romantisme pictural à cette époque, ils cèdent la place à la France. Ce fait s’explique par la situation de tourments sociaux et politiques que connaît ce pays : au moment de la restauration, la société vit une période de crise. Félicité Robert de Lamennais, un écrivain, homme religieux et politique, va très bien qualifier le désarroi de la population : "Le mal du siècle". Les principaux artistes romantiques français : Eugène Delacroix, Théodore Géricault, Alexandre-Gabriel Descamps, Ary Scheffer, Théodore Rousseau, Antoine-Louis Barye. L'une des œuvres les plus représentatives de ce mouvement est Le radeau de La Méduse, réalisée par Géricault en 1818-1819. C’est l’évocation d’une tragédie mais aussi une vision romantique des choses : c’est un drame interne à la société qui est traduit dans cette peinture.
1850-1870 - Le post-romantisme
Le romantisme s'essouffle, il est peu à peu remplacé par le réalisme.
Caractéristiques de la peinture romantique
Là ou le néoclassicisme prône une beauté idéale, le rationalisme, la vertu, la ligne, le culte de l’Antiquité classique et de la Méditerranée ; le romantisme s’oppose et promeut le cœur et la passion, l’irrationnel et l’imaginaire, le désordre et l’exaltation, la couleur et la touche, le culte du Moyen Age et des mythologies de l’Europe du Nord.
Stendhal estime que le néoclassicisme est dépassé et que ce qui est moderne c’est le romantisme (donc les sentiments, la couleur mais aussi l’individualisme). Delacroix dira d’ailleurs du romantisme que c’est « la libre manifestation de ses impressions personnelles» et pour Jean-Jacques Rousseau c’est « l’art de concentrer ses sentiments autour de son cœur ».
Théodore Géricault
Les romantiques ne sont plus fascinés par l’Antiquité et par la Méditerranée mais par le Moyen Âge et par les légendes du Nord. Ils sont aussi très attirés par l’exotisme, surtout les civilisations arabes. Il y a une volonté d’intériorité, de s’intégrer dans l’obscur.
La peinture de paysage prend une grande importance. Cet essor est accompagné par les théories esthétiques du pittoresque et du sublime. L'abandon du classicisme allégorique, du védutisme et de la reproduction topographique de la nature laisse la place à l'imaginaire, au lointain et au sentiment de l'infini. La représentation de la nature sauvage devient le lieu de prédilection où le moi rencontre le monde extérieur. Les tourbillons des vagues tempêtueuses, les cimes esparpées des montagnes et des volcans, les effets de lumière parfois irréels et fantastiques, les cieux orageux et les scènes diluviennes aux accents chaotiques ou apocalyptiques deviennent le reflet des tourments de l'âme et des perceptions hallucinatoires de l'artiste qui s'inspire parfois des grands mythes bibliques pour retranscrire ses visions. En dehors de l'Europe, l'influence de Turner et Constable est sensible sur l'Américain Thomas Cole et le paysagiste russe Ivan Aïvazovski.
On retrouve cette dérive néo-baroque dans le mouvement, la tension, la puissance, les contrastes et les couleurs de ces peintures. Il y a d’ailleurs une parenté entre l'œuvre de Delacroix et celle de Rubens.
D'après Wikipédia
JOHN HODANY
Peintre américain, né en 1974 à New York. Il éétudiéà la Cooper Union School de New York puis à Ateliers 63 à Amsterdam (Pays-Bas).
Son œuvre suit une méthode associant les moyens de la peinture à un processus d'incrustation informatique («Embedded») de type «copier/coller». Il crée des images qui s'apparentent parfois au cartoon, au dessin animé, sur de grands supports papiers qui se déroulent comme des écrans, mais qui ne sont pas sans évoquer également l'univers des estampes japonaises, en beaucoup plus grand.
Il coupe dans la surface peinte et transporte soigneusement ces fragments pour les refixer à de nouveaux emplacements de sorte qu'en disparaissant pour réapparaître au sein de la même composition, les figures donnent l'illusion de s'être déplacées.
Les images de John Hodany charrient des blocs aux arêtes acérées de fin du monde : morceaux de banquise ou rochers volcaniques si l'on veut absolument les identifier, sauf qu'ils apparaissent rien moins que naturels et pourraient tout aussi bien être désignés comme « résidus technologiques ». Hodany invente ainsi des paysages dont les seuls habitants sont quelques animaux choisis parmi ceux qui semblent pouvoir mieux résister aux catastrophes : renard, belette, phoque, hyène, forment une étrange ménagerie qui pose comme une évidence l'absence de l'homme ou le signe annonciateur de sa disparition.
Guy HONORE
MINIATURES PERSANES : LES SEFEVIDES (XVIe/XVIIIe)
Le nouvel essor de la culture persane coïncide avec l'arrivée au pouvoir de la dynastie des Séfévides (1501-1736) qui consolident le royaume. Son fondateur, le chah Ismaïl Ier, descend de Safi al-Din Ardabili (1252-1334), lui-même fondateur d'une confrérie soufie, la confrérie Safavieh, qui petit à petit s'inspire du chiisme, jusqu'à l'adopter, ainsi que le font la plupart des sujets de Perse.
Ismail mène des expéditions victorieuses : de 1501 à 1508, il combat les Turcomans réunis sous la bannière des Moutons blancs et détruit totalement leurs places fortes. Il bataille aussi en Perse occidentale et dans une partie de l'Anatolie orientale. Il défait le khan chaybanide qu'il déteste, mais il commet une erreur en soutenant en 1512 la rébellion des Têtes rouges (soufis majoritairement turkmènes) contre le sultan turc Bajazet. Le fils et héritier de ce dernier, le prince Sélim, soulève des troupes et des janissaires contre son père qu'il contraint à l'abdication et se retourne contre les Perses. Avec une armée aguerrie et bien équipée de deux cent mille hommes, il s'engage jusqu'en Azerbaïdjan occidental. En août 1514, il écrase l'armée persane à la bataille de Tchaldiran près de Tabriz. Les Turcs pillent Tabriz et envoient à Constantinople, conquise depuis un demi-siècle, un grand nombre d'artistes de Tabriz, ainsi que des architectes et des savants dans une capitale dont il fallait toujours relever les ruines.
Dès lors Ismail ne participe plus directement à la guerre, mais continue à soutenir indirectement les Têtes rouges. Son nom est lié au renouveau de l'art persan et à une prospérité retrouvée. Le style en vogue est dénommé « style turkmène » avec des paysages aux décors fantastiques et un grand luxe de détails. L'un des principaux représentants de ce courant est Soltan Mohammad. Trois manuscrits de l'époque illustrent ce nouveau style raffiné : un exemplaire du Khamseh de Nizami commencé sous les Timourides et tombé dans les mains d'un émir d'Ismail qui fait ajouter quelques illustrations en 1504 et 1505 ; ensuite L'Histoire de Djalal et Djamal de Mohammad Assafi qui, après que la calligraphie du texte eut été achevée à Hérat en 1502-1503, est illustré de trente-cinq miniatures. Composées de 1503 à 1505, elles ne le sont pas du tout dans le style de Behzad, mais dans ce nouveau style foisonnant. Enfin le troisième manuscrit est un exemplaire du Livre des rois (« Shahnameh ») commandé par Ismail et dont seulement quatre miniatures sont connues. Malheureusement trois d'entre elles ont disparu ; la quatrième (Roustam endormi) se trouve au British Museum de Londres. Elle est signée de Soltan Mohammad.
C'est véritablement sous le règne du successeur d'Ismail, Tahmasp Ier, que s'épanouissent de nouveau tous les arts persans, et en premier lieu la miniature. Le chah est soucieux de donner un certain prestige à son règne et il est lui-même féru d'art. Il fait de la calligraphie et du dessin. Il a passé sa première enfance à Hérat, mais avec la mort soudaine de son père a dû s'installer à la cour de Tabriz en tant que nouveau chah, alors qu'il avait à peine dépassé l'âge de dix ans. Beaucoup d'artistes, de poètes, de copistes et de savants quittent Hérat et suivent la cour à Tabriz. C'est ainsi que le style hérati de Behzad et de son école - qui s'attache à l'harmonie de la composition - se mélange, mais de façon heureuse, avec le « style turkmène » de l'école de Tabriz, enclin à l'ornementation et au raffinement des détails. Tahmasp fait preuve d'une grande prodigalité. Il entretient une immense ketâbkhâneh (bibliothèque) et réunit sous son patronage une pléiade de grands maîtres, tels que Soltan Mohammad, Agha Mirek, Mir Saïd Ali, Abd al-Samad, Mu'in Mussavvir, Mirza Ali, et tant d'autres.
Les premières années du règne de Tahmasp donnent à Behzad la première place dans la direction des affaires artistiques du royaume, Un projet grandiose est mené avec la commande par le roi d'une nouvelle copie du Livre des Rois (15251535). Le recueil comprend 746 folios de grand format, 258 miniatures de pleine page, et un grand nombre d'illustrations. Tous les meilleurs artistes et spécialistes de la ketâbkhâneh royale y travaillent. Un telle œuvre par son luxe ne peut être comparée qu'aux copies du Livre des rois du temps de l'ilkhanat et les contemporains n'ont jamais rien vu de semblable. Les miniatures sont de différents styles. Certaines sont du pur style de l'école de Tabriz, d'autres de celui de Hérat et d'autres composées de manières plus ou moins mélangées. L'entreprise suivante est la commande d'un Khamseh qui est resté inachevé (certaines places vides laissées dans le texte pour les illustrations ne sont remplies qu'en 1675 par Mohammad Zaman). On y trouve quatorze grandes miniatures qui de façon fort raffinée marquent un tournant dans l'histoire du Livre des rois et des manuscrits de cette époque. Soltan Mohammad et d'autres peintres participent à cette entreprise. En plus de ces grands manuscrits de commande, les artistes, calligraphes, etc. possèdent aussi toute une clientèle de personnages puissants, de courtisans et de seigneurs qui leur commande des miniatures sur des feuillets à part. Beaucoup d'entre elles sont des portraits, souvent des princes idéalisés avec leurs domestiques ou bien de hauts personnages.
Au milieu des années 1540, Tahmasp perd peu à peu le goût de la peinture et de la calligraphie C'est aussi à cette époque que le malheureux empereur Houmayoun trouve asile à la cour de Tabriz, mais il est émerveillé par les artistes locaux. Lorsqu'il s'installe à Kaboul en 1544, il invite Mu'in Mussavvir, Mir Saïd Ali et Abd al-Samad. C'est le début de la grande peinture moghole. Tahmasp, quant à lui, a rompu avec l'art pictural. Il a dû batailler contre des chefs ouzbeks de 1524 à 1537. Les Ottomans lui ont enlevé Bagdad et la Mésopotamie en 1535 et il a dû pratiquer la tactique de la terre brûlée pour repousser les Ottomans. En 1544, le chah repousse encore une attaque ottomane et quand en 1555 il réussit à signer le traité de paix d'Amas, sa reconnaissance envers Allah ne connaît plus de limite. En conséquence, il fait publier dans tout le royaume un « édit de sincère reconnaissance » qui met hors la loi les arts mondains. C'est un coup d'arrêt à la production artistique. Les peintres qui ne peuvent émigrer en Inde se réfugient à la cour du neveu du chah, Soltan Ibrahim Mirza, qui se tient à Mechhed, où il est gouverneur jusqu'en 1564. Beaucoup d'entre eux travaillent à un manuscrit des Sept trônes (Haft aourang) de Djami. Lorsque Ibrahim Mirza est déchu de son gouvernorat pour se retrouver à la tête de la petite province de Sabzavar, il continue de patronner les arts.
Dans les années 1550, Tahmasp déménage sa capitale loin des attaques ottomanes, à Qazvin. Il se détourne de ses mesures précédentes et y ouvre une bibliothèque royale. Ses murs sont recouverts de fresques en 1573 qui représentent des scènes du Hеrchaspnameh d'Assadi dans le style des miniatures de la cour de Mechhed. Une école de peinture fleurit alors à Chiraz. Tahmasp meurt en 1576, ce qui inaugure une période d'instabilité. Son fils puîné Ismaïl II lui succède, après avoir passé vingt ans en prison pour avoir comploté contre son père. C'est un être cruel et jaloux ; il meurt empoisonné par ses officiers. Son frère aîné Mohammad Khoudabende (1577-1588), à moitié aveugle, lui succède, mais il passe son temps dans son harem plutôt que de s'occuper des affaires du gouvernement. Dans le pays, ce ne sont que rivalités et luttes tribales attisées par les ennemis extérieurs. Finalement, Mohammad abdique en faveur de son fils Abbas. Malgré son caractère extrêmement ténébreux, Abbas patronne la bibliothèque royale. Un Livre des rois inachevé de 1576-1577 subsiste de cette époque. Il est aujourd'hui dispersé en plusieurs feuillets.
La mort d'Ismaïl II en 1577 porte un coup funeste à la production de manuscrits royaux. Son successeur Mohammad Khoudabende est à moitié aveugle et donc parfaitement indifférent à l'art de la miniature. La plupart des peintres de la bibliothèque royale de Qazvin se dispersent ailleurs, soit en Inde, soit dans l'Empire ottoman ; d'autres comme Habibollah, Mohammadi, Ali Asgar, cheikh Mohammad ou Sadiq Bek s'installent à Mechhed et à Hérat. Ils peignent surtout pour des raisons commerciales sur des feuillets à part, puisqu'il n'y a plus de grandes commandes royales. C'est ainsi qu'apparaissent de nouveaux thèmes, comme des pastorales, des parties de campagne montrant des princes et de hauts personnages, ou bien encore des scènes de musique en plein air, magistralement composées par Mohammadi par exemple. Toutes ces nouveautés permettent la création en dehors des grandes commandes étatiques d'un marché de l'art en Perse de plus en plus florissant.
Le règne d'Abbas Ier (1587-1629) sauve le pays de l'effondrement total. Ce chah est jeune, énergique ; il écarte ainsi tout ce qui peut affaiblir son pouvoir ou empêcher l'épanouissement national. Ses quarante années de règne sont considérées comme un « âge d'or » de l'histoire iranienne. Il n'a certes pas été chanceux au début dans les affaires extérieures, mais il a tout de suite mis de l'ordre dans les affaires intérieures et a permis ainsi à l'économie de prospérer. C'est seulement après avoir cumulé toutes les forces du pays au début du XVIIe siècle qu'il peut récupérer par l'épée les terres que son père avait perdues au profit des Ottomans. Il fait d'Ispahan sa capitale qu'il orne d'une place royale monumentale, de nouvelles mosquées et de palais magnifiques.
Dans les années 1590, la mode est de peindre des portraits sur des feuillets à part. Ce sont avant tout des personnages de la cour, mais il devient plus fréquent de peindre des cheikhs, des derviches, des personnages laborieux et même des concubines. Avec la prospérité du pays, apparaît un nouveau type de jeunes élégants vêtus à la mode dont les portraits sont réunis dans des albums. Mohammadi et Sadiq Bek continuent de travailler, mais l'innovation est représentée par le fils d'Ali Asgar, le grand Reza Abbasi. Reza prend part à l'illustration de manuscrits enluminés, mais surtout exprime la virtuosité de son art dans des feuillets à part. La période d'activité de Reza est fort longue, puisqu'elle débute à la fin des années 1580 pour se prolonger jusqu'en 1635. Il change plusieurs fois de style.
Au début du XVIIe siècle, les voyageurs européens pénètrent de plus en plus dans le royaume. Ils apportent avec eux des illustrations et des gravures, des livres comportant des planches, etc. qu'ils vendent aux Perses ou bien qu'ils offrent à leurs hôtes. Les Anglais de la Compagnie des Indes et les Hollandais de la Compagnie des Indes néerlandaises commencent à ouvrir en Iran des magasins et comptoirs de textiles. Des Européens arrivent : ce sont surtout des aventuriers, des négociants, des diplomates, quelques missionnaires, qui s'installent non seulement à Ispahan la capitale, mais aussi dans des grandes villes. Abbas Ier fait déporter d'Arménie un grand nombre de personnes dans un quartier spécial d'Ispahan, la Nouvelle Djoulfa, afin de développer les ressources et les débouchés économiques. Toutes ces influences diverses se sentent dans les miniatures. Une autre source de mélange des influences est la nouvelle peinture moghole. Celle-ci arrive d'Inde où l'empereur Akbar le Grand (1556-1605) favorise une idéologie multiculturelle, dont l'une des facettes est la libre diffusion de l'art européen et la tolérance du christianisme.
Malgré le fait que Reza utilise quelques sujets de la gravure européenne, il n'en demeure pas moins fidèle à la tradition persane, comme de ne pas suivre les règles de la perspective ou de ne pas faire d'ombre et lumière. La situation commence àévoluer vers 1640 et les successeurs de Reza expérimentent de plus en plus les canons et les sujets européens, bien que jusqu'à la fin du XIXe siècle la peinture persane soit presque totalement produite selon les canons de la tradition. Il ne s'agit donc que d'adaptations ou de touches. La peinture persane quant à elle meurt en tant que tradition vivante au début du XXe siècle.
L'influence de l'art de Reza Abbasi sur les peintres du XVIIe siècle est tout à fait particulière. Mir Afzal Tuni peint dans sa première période selon l'esprit de son maître Reza, à tel point que certains experts se sont trompés dans l'attribution des œuvres. Il participe entre 1642 et 1651 à l'enluminure d'une version du Livre des rois commandé par un haut fonctionnaire de la cour. D'autres artistes travaillent à une version du Livre des rois destinée au mausolée de l'imam Reza à Mechhed. Elle est achevée en 1648. L'un des enlumineurs est Mohammad Youssouf, célèbre pour ses portraits sur feuillets à part ; Mohammad Kassim est un des autres enlumineurs. Il travaille à la manière de Reza, sans le copier servilement, mais en composant des variations originales. Le fils de Reza, Mohammad Chafi Abbasi, se fait aussi connaître par ses décors de fleurs et d'oiseaux dans le goût persan adaptés de l'art chinois, non sans quelques concessions à l'art occidental.
Mohammad Ali qui œuvre dans la seconde moitié du XVIIe siècle se distingue par ses portraits de femmes raffinées, d'élégants jeunes gens et d'ermites. Cependant la figure la plus importante de la peinture persane de cette époque est sans conteste Mu'in Musavvir, élève le plus fameux de Reza. Il s'essaye à différents genres, de l'enluminure, à la production sur feuillets à part, dont les dessins aux trait fins et libres sont remarquables. Un autre maître, Djami, laisse des dessins dont on remarque l'influence européenne, car les traits de ses personnages sont légèrement modelés sur des effets d'ombre et lumière, et ils sont toujours suivis d'ombre, ce qui est absolument inhabituel pour la miniature persane. L'artiste se faisait appeler « faranghi saz », c'est-à-dire peintre dans le style franc (ou français). Un certain nombre de visiteurs européens commandent des œuvres à ces maîtres afin de fixer leurs impressions de voyage en Perse et d'en rapporter un souvenir en Europe.
Le chah Abbas II fait construire en 1647 à Ispahan le palais Tchehel Sotoun dont il fait recouvrir les murs de fresques. Les auteurs ne sont pas tous connus, mais certaines parmi les plus belles sont du pinceau de Mohammad Kassim. Les ombres portées sont respectées, tout en gardant le style traditionnel de la miniature persane. Une salle du palais est couverte de scènes de parties de campagne, une autre de sujets de la littérature classique et la salle principale est ornée de scènes historiques avec la représentation de réceptions par les chahs de diplomates étrangers, ou bien des batailles d'Ismaïl Ier. Ces œuvres sont copiées par les peintres en des formats plus réduits, en peintures sur laque.
En 1720, le pays est secoué par des révoltes qui détruisent les frontières et amènent les Afghans en 1722 à la tête du pouvoir avec Mahmoud Ghilzai. Celui-ci est victorieux de l'armée persane près d'Ispahan, et après sept mois de siège la capitale se rend. Soltan Hossein donne sa couronne à Mahmoud.
La dynastie des Séfévides cesse d'exister. Le dessin de Mohammad Ali intitulé Distribution des cadeaux de Nouvel An au chah Soltan Hossein peut servir d'épitaphe à cette époque. L'auteur malgré la banalité de cette scène officielle a réussi en son genre à transmettre l'atmosphère macabre du crépuscule de la dynastie des Séfévides.
La peinture de l'époque séfévide a trouvé en deux siècles la voie de la synthèse des styles d'écoles différentes : celle d'Hérat, celle de Tabriz, celle de Chiraz. Cette synthèse se réalise dans l'œuvre de Reza Abbasi qui est issu de la tradition persane mais de plus en plus influencée par l'art occidental.
D'après Wikipédia
GEER VAN VELDE
Gerardus Van Velde, dit Geer Van Velde (Lisse, Pays-Bas, 5 avril 1898 - Cachan, France, 5 mars 1977), est un peintre néerlandais.
Il est le second fils de Willem Adriaan Van Velde, alors patron d'une petite affaire de transport fluvial de bois de chauffage et de charbon sur le Rhin et de Hendrika Catharina, fille illégitime d'un comte. La famille comptera quatre enfants et sera vite abandonnée par le père après la faillite de son commerce, laissant dans une grande misère les enfants et la mère qui « s'usera en lessives pour survivre ».
Déménageant beaucoup, ils finissent par s'installer à La Haye en 1903. À l'âge de douze ans, Geer devient apprenti décorateur dans la firme Schaijk & Kramers où Eduard H. Kramers l'encourage à développer son intérêt pour la peinture. L'expérience est enrichissante. Travailler la texture comme apprenti décorateur, puis affronter le carnet à dessins ou les premières toiles permet le meilleur enseignement au rapport matière, couleur, surface. Geer fait son service militaire dans la Croix Rouge puis entreprend le tour des Flandres à pied en peignant des enseignes pour gagner sa vie et en profite pour peindre sur le motif. Ce sera là la seule école artistique de cet autodidacte.
Les premiers dessins ou aquarelles de Geer Van Velde où la structure d'une église ou d'une maison échappe à sa lourdeur par un savant travail mêlant le plein et le vide et noyant l'ensemble sous des harmonies d'un grand coloriste, contient tout l'héritage flamand du paysage. Et même s'il le reniera un temps, Geer finira par lui rendre hommage et ne cessera de retourner vers ce pays âpre et douloureux.
En 1925, Geer rejoint à Paris son frère aîné pour visiter l'Exposition des Arts Décoratifs et décide de se consacrer à la peinture. Ils élisent domicile à Bellevue, et font la connaissance de Tjerk Bottema, peintre satiriste néerlandais comme eux, qui s'illustrera plus tard dans la caricature anti-nazie.
Entre 1929 et 1932, Geer visite le sud de la France, prépare une exposition personnelle qu'il ne peut assurer faute d'argent et fait un aller-retour La Haye-Paris. En 1933, il épouse Elisabeth Jokl qu'il a rencontrée à Montparnasse et s'installe avec elle dans le XIIIe arrondissement.
En 1937, Geer van Velde fait la connaissance de Samuel Beckett, de dix ans son cadet. L'écrivain irlandais est encore un inconnu, mais l'homme porte en lui ce pouvoir de cristallisation qui génère les œuvres fortes, ce que Geer cherche également en lui-même, et tous deux partagent une interrogation sur l'homme et son temps. Ils seront amis, même si cette amitié passera par certains antagonismes. En 1938, grâce à Beckett, le peintre expose quarante-cinq toiles chez Guggenheim Jeune à Londres, alors sous la direction de Peggy Guggenheim. L'exposition est un échec cuisant et Geer quitte Paris pour s'installer à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) où il demeurera jusqu'en 1944. Se liant d'amitié avec Pierre Bonnard, il fera là de nombreux dessins et peindra des figures féminines en dialogue avec les objets du quotidien : des rideaux, un guéridon, une plante... En 1942, il expose à Nice.
Dans les derniers mois de 1944, le peintre quitte le midi pour s'installer à Cachan (Val-de-Marne), dans une petite maison. Ce sera son définitif point d'ancrage, l'atelier d'où sortiront toutes les œuvres à venir. Il participe aux principaux salons et manifestations culturelles internationales, comme au Salon de Mai et au Salon des réalités nouvelles de Paris.
Après-guerre, Geer van Velde fait plusieurs voyages en Hollande qui lui permettent de retrouver la lumineuse rigueur de son pays comme de se familiariser avec l'œuvre de Piet Mondrian, décédé en 1944, dont l'œuvre est pour la première fois présentée en rétrospective au Stedelijk Museum d'Amsterdam en 1946. La même année, il expose chez Aimé Maeght une quarantaine de toiles issues de son travail dans le midi. L'accueil de la critique est plus que réservé, mais cela ne déstabilise guère l'artiste qui continue son dialogue intérieur et collaborera deux fois encore avec la galerie (1948 et 1952). En 1947, quelques-unes de ses toiles sont exposées au Palais des Papes lors du premier Festival d'Avignon. En 1948, il expose avec son frère à la Kootz Gallery de New York. L'artiste se lie avec le critique d'art et écrivain Michel Seuphor, grand défenseur de Mondrian en France. Cette rencontre est fertile en réflexions sur l'abstraction. Par ailleurs, à l'époque où les articles sont encore rares, Seuphor rend compte du travail de Geer Van Velde dans le catalogue de l'exposition De Matisse à Miro chez Pierre-André Benoit en 1948.
À l'occasion de la première Biennale de Menton en 1951, Geer Van Velde reçoit le Premier Prix de la ville en tant que peintre étranger. De 1952 à 1962, l'artiste va voyager et exposer à l'étranger, des Pays-Bas à la Suède en passant par la Suisse, l'Allemagne et l'Italie, le plus souvent dans des manifestations collectives autour de la Nouvelle Ecole de Paris. En 1963, il est au Brésil pour deux expositions personnelles. Après un voyage en Irlande, il expose seul au Musée Galliéra de Paris puis à Cagnes-sur-Mer et Amsterdam. Ses voyages l'emmènent en Grèce, Algérie et à Jérusalem. En 1973, la Biennale de Cachan s'ouvre sur un hommage à Geer et à Braque et, en 1976, il participe, au musée des arts décoratifs de Paris, à la rétrospective des activités des Pierlot au château de Ratilly.
Geer Van Velde, solitaire peu bavard, meurt à Cachan, le 5 mars 1977.
D'après Wikipédia
LUCAS CRANACH L'ANCIEN
Lucas Müller, dit Lucas Cranach l’Ancien, né le 4 octobre1472àKronach en Haute-Franconie (Allemagne) et décédé le 16 octobre1553àWeimar (Allemagne), est un peintre et graveur de la Renaissance allemande. Il est le père de Lucas Cranach le Jeune.
Ses origines et ses années de formation sont presque totalement inconnues. Son nom provient de celui de sa ville natale. Son père, Hans aurait été peintre.
Entre 1501 et 1504, il voyage dans la vallée du Danube jusqu’àVienne, où il fréquente alors les milieux humanistes. Il peint durant cette période des tableaux d’inspiration religieuse ainsi qu’un portrait.
À cette époque, son style, proche de celui d'Albrecht Dürer, ou d’Albrecht Altdorfer, se caractérise par la prédominance des paysages agités, aux couleurs fastes, emplis d’une quantité de détails et de symboles, d’un lyrisme exacerbé, paysages quasi surréalistes où la tension psychologique est palpable, espaces vitaux dans lesquels s’insèrent avec harmonie des personnages élaborés et à l’expression énigmatique. Les trois artistes ont d'ailleurs l'occasion de travailler ensemble, lors de la réalisation d'un livre d'heures en 1515 pour l'empereur Maximilien.
Il s’établit àWittenberg en 1505 et devient peintre de cour auprès de l’électeur de SaxeFrédéric le Sage. Il est anobli en 1509 et reçoit du prince-électeur des armoiries représentant un dragon ailé portant un rubis, qui sera sa signature et celle de son atelier sur de très nombreux tableaux. Son activité change. Ses protecteurs, comme le cardinal Albert IV de Brandebourg attendent de lui non seulement des retables et des portraits, mais aussi des œuvres décoratives pour leurs fêtes et les intérieurs de leurs nombreuses demeures. Pour faire face aux nombreuses demandes, Cranach met sur pied un atelier où ses deux fils travaillent.
Un exemple très intéressant de l'organisation du travail entre Lucas Cranach et son atelier est la série de treize portraits, conservés par le Musée des Beaux-Arts de Reims. Dix sont attribués à Lucas Cranach et trois à son fils. Ce sont des études, dessinées à vif par le maître, d'une technique rapide à la détrempe, qui permet des indication de couleurs, sur un support léger et facilement transportable (papier vergé et collé sur carton). Ces esquisses de têtes grandeur nature, révèlent un artiste proche de ses modèles, et un habile dessinateur. À partir de ces « prototypes » l'artiste ou l'apprenti de l'atelier réalisait des portraits individuels ou collectifs, peints à l'huile. Il pouvait alors à sa guise, coiffer, habiller le personnage en fonction des modes, de son âge et le placer dans le décor de son choix. Les personnages représentés sont pour la plus part identifiés et appartiennent aux familles princières et ducales de Saxe et de Poméranie.
À partir de cette date, Cranach tourne le dos à la spontanéité de sa période viennoise et son art s’oriente alors vers un style s’approchant du maniérisme : les formes s’allongent, deviennent plus souples, les personnages prennent de l’importance par rapport au paysage devenu simple décor, leurs différentes poses sont élaborées et codifiées, et l’habillage raffiné.
Certains historiens de l'art voient dans ce changement le début de la décadence qui va s'accentuant après 1525. D'autres jugent la production des années 1505 à 1525 d'égale valeur, quoique très différente de celle des années viennoises.Cette simplification voulue des formes, des compositions et des couleurs permet à l'atelier de copier à la demande, avec de simples variantes, les créations du maitre. Il crée ainsi une figure féminine idéale et stylisée sur des canons anti-classiques. Le pouvoir de séduction de l'artiste réside dans l'utilisation du pouvoir suggestif de la ligne sinueuse et du contraste des couleurs disposées en larges surfaces.
Dans La Vénus de 1529, Cranach reprend un sujet très classique de la Renaissance pour en faire une œuvre d'un érotisme ambigu. Représentée nue comme le veut la tradition, la Vénus est une jeune fille oblongue aux formes prépubères. Mais loin d'être pudique, elle porte un collier à la manière des courtisanes, elle montre son sexe d'un doigt et regarde le spectateur d'un œil aguicheur. Le paysage stylisé renvoie à l'Allemagne de son époque.
ÀWittenberg, il fait la connaissance de Martin Luther avec qui il se lie d’amitié (et dont il réalisera de nombreux portraits). Luther et lui étaient amis intimes, chacun étant aussi le parrain d'un des enfants de l'autre. Acquis aux idées luthériennes, Cranach participera dès lors à la création de l’iconographie protestante, représentant des thèmes chers à la Réforme, tirés de l’Ancien Testament et du Nouveau Testament, introduisant quelquefois des citations de la Bible. Il peint également de nombreux portraits et scènes religieuses qui lui assurent la célébrité dans toute l’Europe.
Propriétaire d’une pharmacie et d’une imprimerie, il est élu à trois reprises bourgmestre de Wittenberg et conserve sa charge de peintre de la cour sous les électeurs Jean-Constant et Jean-Frédéric, cour pour laquelle il peint d’innombrables nus bibliques et mythologiques à l’érotisme allusif.
Jean-Frédéric, porta sa cour àWeimar en 1547 et Lucas Cranach l'y a suivi.
Son protecteur Jean-Frédéric ayant été capturé après la bataille de Mühlberg, Cranach accompagne sa captivité de 1550à1552 avant de revenir àWeimar, nouvelle résidence électorale, pour y mourir l’année suivante.
Il a produit de nombreuses œuvres dont l'attribution est parfois difficile, les signatures différentes et l'activité de son atelier étant importante (près de 600 œuvres). Du fait de l'organisation du travail avec des prototypes, certaines années, après 1525, on retrouve ainsi quatre tableaux sur le même thème avec des variantes relativement discrètes, les visages, les attitudes et même les couleurs restant très similaires.
Après sa mort, son fils Lucas Cranach (dit le Jeune) continue l’activité de son père et de son atelier.
Vignette en haut à gauche : portrait de l'artiste par son fils.
D'après Wiki
NISHIKI-E
Nishiki-e, « estampe de brocart», également appelé Edo-e, en référence à la capitale de l'époque, est une des étapes techniques de la mise en couleur des estampes japonaises. Elle fut utilisée principalement dans l'ukiyo-e.
Les nishiki-e furent inventée vers 1760, puis perfectionnées et popularisées par Suzuki Harunobu, dans un premier temps au travers des e-goyomi (« estampes-calendriers »). C'est en effet par le goût des riches Japonais pour les luxueux egoyomi, ces calendriers sous forme d'estampes destinés à contourner le monopole d'État, qui a permis à Harunobu d'entreprendre les coûteux perfectionnements qui ont mené aux nishiki-e. Harunobu produisit alors un grand nombre de nishiki-e entre 1765 et sa mort, cinq ans plus tard.
Auparavant, le texte était habituellement monochrome, tout comme les illustrations de livres, mais la popularité croissante de l'ukiyo-e créa une demande pour un nombre de couleurs croissant et une plus grande complexité des techniques.
Cette technique implique des planches de bois multiples, une planche principale portant le dessin proprement dit, puis une pour chaque portion de l'image, permettant d'utiliser un grand nombre de couleurs différentes, et de parvenir à des images très complexes et détaillées. Des marques nommées kentō sont utilisées pour le positionnement exact de chaque planche.
D'après Wikipédia
DAMIEN HIRST
Damien Steven Hirst est un artiste britannique, né le 7 juin 1965 à Bristol. Il vit et travaille à Londres. Il a dominé la scène de l'art britannique dans les années 1990 en tant que membre du groupe des Young British Artists. En 1995, il est lauréat du Turner Prize.
Il a grandi à Leeds. Sa mère épouse William Hirst, lorsqu'il a un an, il portera son nom. Son beau-père est mécanicien et sa mère employée dans l'administration. Ils divorcent lorsqu'il a douze ans. Il se montre indiscipliné pendant son enfance et le dessin est le seul domaine dans lequel il a pu se distinguer positivement dans ses études.
Ses résultats scolaires ne lui permettent d'entrer au lycée que grâce à l'intervention de son professeur d'art. Il est refusé au Leeds College of Art, mais réussit à y entrer par la formation diplômante de 2 ans proposée par l'établissement. Il déménage à Londres où il travaille deux ans sur un chantier de construction pour poursuivre ses études artistiques. Rejeté de Saint Martins School of Art, il entre finalement en 1986 au Goldsmith's College of Art jusqu'en 1989, pour étudier les beaux-arts.
Dès les années 1980, il mène de front un travail de sculpteur et de commissaire d'exposition qui marque la naissance du courant des Young British Artists. Sa première exposition personnelle a lieu en 1991 (In and Out of Love).
Depuis 1988, Damien Hirst réalise des installations où il traite du rapport entre l'art, la vie et la mort. Pendant ses études, il a travaillé dans une morgue et le thème de la mort devient central dans son travail. Pour les cabinets médicaux, il expose dans des vitrines des objets provenant « de la vie réelle » comme des tables, des cendriers, des mégots, des médicaments (formol), des papillons, des poissons…
À partir de 1991, pour « que l'art soit plus réel que ne l'est une peinture », il travaille sur une série constituée de cadavres d'animaux (cochon, vache, mouton, requin, tigre...) Les bêtes (parfois coupées en deux, laissant apparaître les organes) sont plongées dans le formol et présentées dans des aquariums. Ces sculptures sont appelées à disparaître (la putréfaction n'est que ralentie), elles perdent peu à peu leurs couleurs et se délitent.
Depuis 1993, il monte en parallèle une suite de peintures monochromes ponctuées de papillons naturalisés (I Feel Love, 1994-1995). Il réalise également une vidéo pour le groupe Blur (The Country House, 1995), un court métrage ainsi que des peintures en collaboration avec David Bowie ou la décoration d'un restaurant branché de Londres.
En 2003, il densifie son propos en montrant des monochromes noirs habités de mouches mortes, des reliquaires de martyrs, des vitrines où des têtes de vaches représentent le Christ et les apôtres ; ses installations sont éclaboussées de sang d'animal figé sur le sol ou sur les murs des lieux d'exposition (Blood, 2003).
Le 21 juin 2007, une de ses œuvres, Lullaby Spring, une armoire à pharmacie métallique contenant 6136 pilules faites à la main et peintes individuellement a été vendue 19,2 millions de dollars par la salle de vente londonienne Sotheby's. Il s'agit de la deuxième œuvre la plus chère jamais vendue aux enchères pour un artiste vivant, après un portrait de Lucian Freud.
En août 2007, Damien Hirst bat un nouveau record en cédant pour 100 millions de dollars une pièce intitulée For the love of God, réplique en platine du crâne d'un homme décédé au XVIIIe siècle, incrustée de 8601 diamants. Le journaliste et critique d'art Ben Lewis révèlera plus tard dans son documentaire L'art s'explose, que l'œuvre, ne trouvant pas acquéreur, a en fait été achetée par un groupe d'investisseurs dont Hirst faisait lui-même partie dans le but, semble-il, de préserver sa cote sur le marché de l'art...
Les premières Spot paintings présentent des alignements de points colorés dont les titres évoquent le monde médical, thématique que l'on retrouve dans ses sculptures installations. Les secondes Spin paintings utilisent la force centrifuge. Les toiles de cette série sont de forme circulaire. Le Spin art courant issu de l'Action painting est apparu dans les années 1960.
En septembre 2008, Hirst organise une vente aux enchères de ses œuvres les plus récentes chez Sotheby's, à Londres, au lieu de passer par le circuit des galeries, lesquelles se sont pourtant imposées depuis le XIXe siècle comme les intermédiaires naturels entre les producteurs et les consommateurs du monde de l'art. Il viole ainsi une règle importante du marché de l'art. La vente est un grand succès et les articles sont vendus au-delà de toutes les estimations.
Ben Lewis affirme cependant que les marchands d'arts traditionnels, et notamment Larry Gagosian et Jay Jopling, fondateur de la galerie White Cube à Londres, étaient présents à la vente et ont, là encore, exagérément fait monter les enchères, dans le but de préserver la bulle spéculative autour de l'œuvre de Hirst dont ils possèdent des stocks importants.
En octobre 2015, Damien Hirst ouvre sa propre galerie, la Newport Street Gallery, située dans le sud de Londres. Ce nouvel espace a vocation de présenter des expositions monographiques et collectives d'artistes chers à Damien Hirst.
fait avec des ailes de papillons
D'après Wikipédia
GEORGES SEURAT
Georges-Pierre Seurat, néà Paris le 2 décembre 1859 et mort le 29 mars 1891 dans la même ville, est un peintre français, pionnier de la technique de chromo-luminarisme, ou peinture optique, appelée plus couramment pointillisme ou divisionnisme. Peintre de genre, figures, portraits, paysages animés, paysages, peintre à la gouache, dessinateur.
Il naît dans une famille bourgeoise. Son père, huissier de justice auprès du tribunal de la Seine, est un homme solitaire, un caractère dont hérite son fils. Sa mère, Ernestine, a une sœur, Anaïs, épouse de Paul Haumonté, marchand de toile et peintre amateur qui comptera dans la première formation du jeune Georges.
En 1877, il s'inscrit à l'Ecole des beaux-arts de Paris où il fréquente l'atelier d'Henri Lehmann, mais ses études sont interrompues par son service militaire qu'il effectue à Brest, où il réalise de nombreuses esquisses de bateaux, de plages et de la mer. En 1882, il se consacre à la maîtrise du noir et blanc et commence à peindre réellement.
Il invente la technique du chromo-luminarisme (plus couramment appelé pointillisme), qui s'inspire des écrits théoriques du critique Charles Blanc (Grammaire des arts du dessin, 1867) et de sa lecture de la loi du contraste simultané des couleurs du chimiste Michel-Eugène Chevreul et de la Théorie scientifique des couleurs, (1881) , d'Ogden Rood. Il achève, en 1884, Une baignade à Asnières, le premier des six grands tableaux qu'il va peindre dans sa courte vie. Sa technique séduit rapidement de jeunes peintres, Paul Signac, Henri-Edmond Cross, Charles Angrand, Maximilien Luce ainsi que Camille Pissarro.
Seurat participera à la formation de la Société des artistes indépendants, ouverte sans jury ni récompenses. Il est fortement soutenu dans ses recherches picturales par le critique Félix Fénéon, qui acquerra Une baignade à Asnières, sera son exécuteur testamentaire avec Paul Signac et Maximilien Luce, et l'initiateur du catalogue raisonné de son œuvre - achevé par César M. de Hauke en 1961.
L'été 1890, le peintre réside à Gravelines (Nord). Il écrit une révision des concordances entre les caractères des tons (sombres ou claires), des teintes (froides ou chaudes), des lignes (tombantes et tristes ou ascendantes et gaies). À son retour à Paris, il met en projet son tableau Le Cirque qu'il montre, inachevé, au huitième Salon des indépendants.
Il meurt subitement en 1891, pendant l'exposition, à l'âge de 31 ans, probablement des suites d'une angine infectieuse (ou diphtérie). Sa famille découvrira à cette occasion qu'il entretenait depuis plusieurs années une liaison avec Madeleine Knobloch, de qui il avait eu un fils, Pierre Georges, né le 16 février 1891, et qui devait d'ailleurs mourir deux semaines après son père, de la même infection.
Seurat incarne une nouvelle génération de peintres qui annonce la désintégration de l’idéal impressionniste et l’avènement de conceptions nouvelles ; il dépasse avec détermination l’immédiateté de la peinture impressionniste pour élaborer une méthode picturale qu'il prétend fonder sur des lois scientifiques et révolutionner le concept même de l’art figuratif. Son problème étant de trouver un lien entre l’art et la science et, plus précisément, entre la peinture, la physiologie et la psychologie de la perception.
Seurat expérimente une nouvelle technique de peinture appelée pointillisme. Le procédé consiste à poser sur la toile de nombreux petits points de couleur pure de manière à créer, à distance, le mélange et la vibration de la lumière. Si les impressionnistes juxtaposaient aussi de nombreuses taches de couleur pure, Seurat, au lieu de compter sur la perception immédiate, a fondé sa méthode sur une justification scientifique rigoureuse.
D'après Wikipédia
MINIATURES PERSANES : XVIIIe ET XIXe
Cinq ans après la mort de Nâdir Châh, Mohammad Karim Khan (1705-1779), commence son ascension politique. Il parvient à anéantir ses opposants des tribus bakhtiares et des Qadjars turcophones. Toutefois contrairement à Nâdir Châh, il se concentre plus sur les problèmes intérieurs que sur les expéditions guerrières. Il panse ainsi les blessures dues au gouvernement des Afghans et au règne de Nâdir. L'artisanat renaît, le commerce est rétabli, les constructions reprennent.
1721
Un grand nombre de palais sont construits à Chiraz, la nouvelle capitale. Leurs murs sont recouverts non seulement de représentations de réceptions officielles et de victoires, mais aussi de sujets tels que le sacrifice d'Abraham ou bien Moïse faisant paître son troupeau. Les thèmes les plus répandus sont la représentation de princes, de beautés féminines jouant de la musique ou dansant. Les tableaux possèdent souvent un dessus en forme d'arc pour donner l'illusion d'une fenêtre ouverte. Quelques artistes, comme autrefois, travaillent dans le genre « fleurs et oiseaux » que prisait Mohammad Chafi Abbasi. La peinture sur laque prend un grand essor, mais aussi une importante production commerciale de basse qualité qui copie souvent d'anciennes miniatures. Cette production de bazar est destinée aux Européens et aux Perses peu fortunés.
La tribu des Qadjars se renforce cependant. Elle vit dans le nord de l'Iran aux alentours de la ville d'Astrabad. Au milieu des années 1780, ils ont la mainmise sur tout le Nord de l'Iran et font de la petite ville de Téhéran leur capitale. Elle demeure la capitale de la dynastie qadjare, après que son fondateur, Agha Mohammad, se soit proclamé chah. Son règne ne se poursuit pas, car il est assassiné en 1797. Son héritier est son neveu, Fath Ali (1797-1834) dont le règne se passe dans une certaine tranquillité. Les désagréments sont surtout liés à la politique de l'Empire russe qui ôte aux Perses les territoires chrétiens de la Géorgie, d'une partie de l'Arménie, tandis qu'une politique de guerre commerciale et tarifaire est enclenchée par l'Iran.
Avec l'arrivée de cette nouvelle dynastie, l'art pictural perse change profondément. Il prend le nom d'« art qadjar » et demeure jusqu'à un peu plus de la moitié du XIXe. Le style qadjar est avant tout un art de cour dans son esprit et un style éclectique dans son destin, avec de fortes tendances archaïsantes. Le règne de Fath Ali est empreint d'un certain éclat, d'une certaine pompe même, avec des palais luxueux et une cour brillante. C'est sous ce règne que cette dynastie récente tente de redonner vie à un art de vivre de cour disparu et à l'art antique persan. La cour commande des portraits officiels, des scènes de bataille, toujours pompeuses et théâtrales. La quintessence de ce style, ce sont les nombreux portraits du chah qui ressemblent quelque peu à des portraits d'opérettes… Les premières œuvres de ce style qadjare se caractérisent par leur fond plat, le grand rôle de l'ornementation, l'attention aux détails et aux étoffes, etc.
La première moitié du XIXe siècle connaît comme autrefois des commandes de manuscrits enluminés, avec plusieurs versions du Livre des rois et d'autres œuvres traditionnelles, mais le style des miniatures, quant à lui, est fort éloigné de la tradition classique. Le neveu de Fath Ali, Mohammad Ali, lui succède. Il règne jusqu'en 1848 à une époque où la rivalité des Anglais et des Russes s'exerce de plus en plus. Elle culmine sous Nasseredin (1848-1896). Cependant le chah suit mal à propos les conseils des Anglais et son règne coïncide avec un profond ressentiment dans la population, misérable et majoritairement analphabète, tandis que les classes cultivées sont également mécontentes. Il finit par être assassiné. Le trône échoit à son fils Mozaffaredin qui règne jusqu'en 1907.
1853
Nasseredin est un profond admirateur de tout ce qui est occidental, y compris de sa technique ou de ses beaux-arts. Des écoles de dessin et des ateliers de peinture sont ouverts dans le royaume, où y enseignent des maîtres européens ou des artistes persans ayant étudié en Occident. La figure centrale de cette période est le peintre Kamal-ol-molk qui peint des toiles à l'européenne, dans un style proche des Ambulant russes. Un autre peintre connu d'alors est Abolhassan Ghaffari (dit Sani-ol-molk) (1814-1866) qui a étudié cinq ans en Italie. Le portrait est le genre qui domine. D'autre part, comme le souverain est passionné de photographie, il fait aussi ouvrir un collège technique à Téhéran pour l'apprentissage de la photographie avec des spécialistes venus d'Europe. Lui-même est l'auteur de nombreuses photographies de ses proches et de sa famille. À cette époque, le but de la peinture est d'égaler la précision photographique. Cette tendance se poursuit jusqu'au début du XXe siècle.
D'après Wikipédia